
Hier
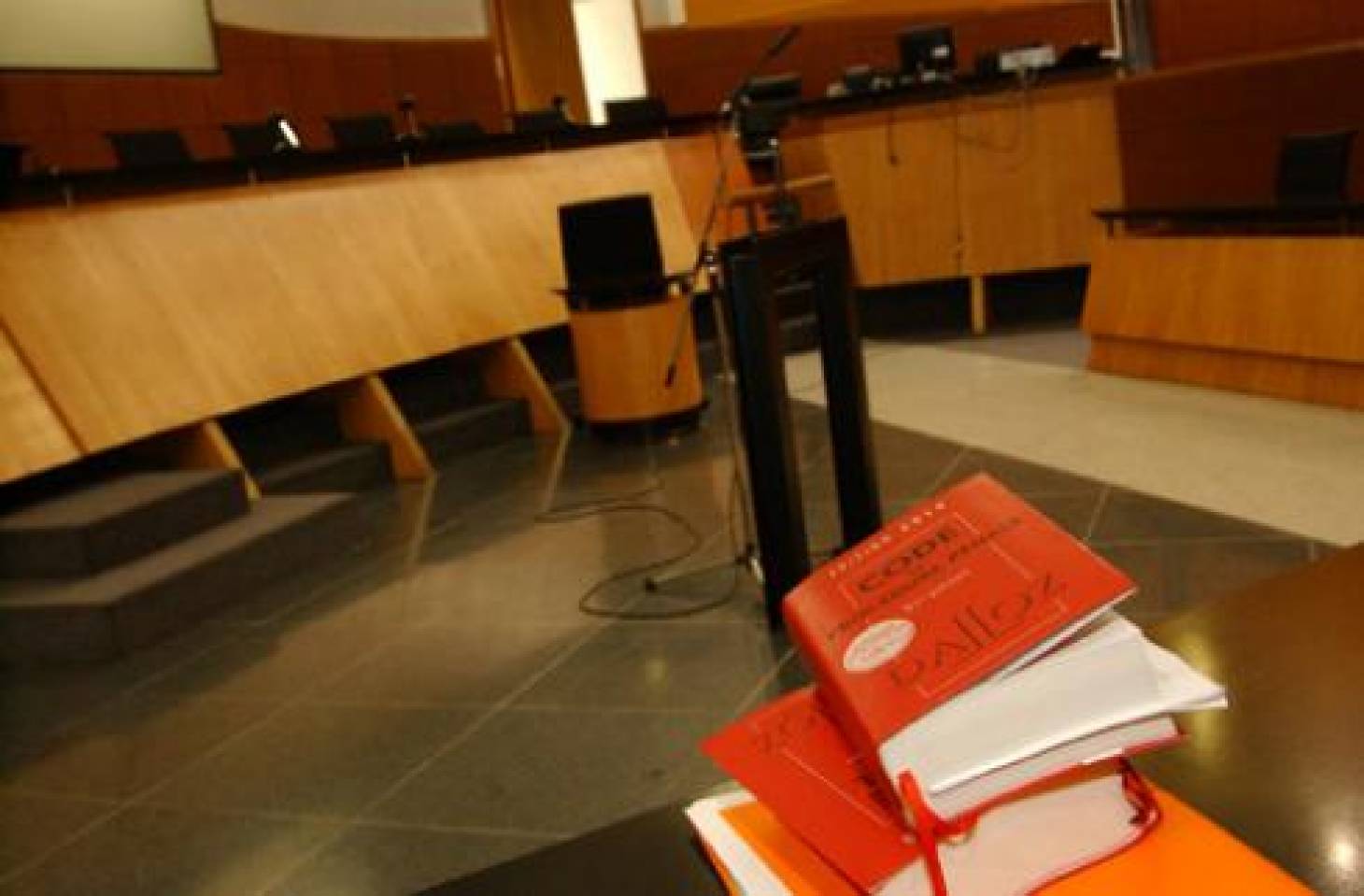
Sa carte de visite et ses études longues comme le bras attestent d’un engagement sans faille à la noble cause de la Justice. Troisième cycle de droit pénal en poche, Mathilde (ndlr : le prénom a été changé) est prête au grand saut. Nous sommes au début de l’année 2011. La jeune femme, étudiante à Poitiers, présente sa candidature au concours d’entrée de la rutilante Ecole nationale de la Magistrature. Le rêve est en marche. Au soir du printemps, le couperet tombe : « Refusée ! » Pourquoi elle ? « Elle était loin de s’imaginer que de vieilles affaires presque futiles pourraient contrarier ses espoirs. » Avocat à la cour et maître de conférences à l’université de Poitiers, Manuel Carius est saisi
du dossier. Il comprend très rapidement le motif de la sentence. « En 2008, ma cliente a été soumise à un contrôle d’alcoolémie qui s’est avéré positif. Elle a été jugée par ordonnance pénale et condamnée à 200€ d’amende et deux mois de suspension de permis. C’est cette infraction qui a conduit le Garde des Sceaux, « sélectionneur en chef » des candidats à l’ENM, à s’opposer à son admission. » Selon le ministre, l’étudiante a manqué à ses devoirs de « bonne moralité ». Me Carius s’emporte : « Certes, la loi organique relative au statut de la magistrature stipule que les candidats à l’auditorat doivent « jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ». Mais aucun texte ne donne la moindre définition de cette « bonne moralité ». Pire, elle ne délimite aucun cadre. Ni la morale, ni la moralité ne disposent d’un contenu précis et objectivable. »
« Une anomalie juridique »
Pour Manuel Carius, le flou juridique autour des élèves juges est une aberration. Dans le cas de sa cliente, il s’agit d’ « une atteinte à l’égalité et au respect de la vie privée ». « Les magistrats, éclaire-t-il, sont les seuls fonctionnaires de notre pays à ne disposer d’aucune référence écrite sur l’incompatibilité d’une condamnation avec l’exercice de leur fonction ou future fonction. »
Soucieux que le cas de sa cliente « serve l’exemplarité », l’avocat poitevin a posé, il y a quelques semaines, devant le tribunal administratif de Paris, une Question prioritaire de constitutionnalité et l’a plaidée, mardi dernier, devant le Conseil constitutionnel. « Cette démarche n’a qu’une ambition, explique-t-il. Faire en sorte que la lumière soit définitivement faite sur ce que je n’hésite pas appeler une anomalie juridique. Il est inconcevable qu’aujourd’hui encore, un élève juge soit soumis à des évaluations inégalitaires. Tant que la frontière entre l’interdit et l’immoral ne sera pas légalement défini, l’arbitraire règnera en maître. »
Décision du Conseil constitutionnel le 5 octobre.
À lire aussi ...