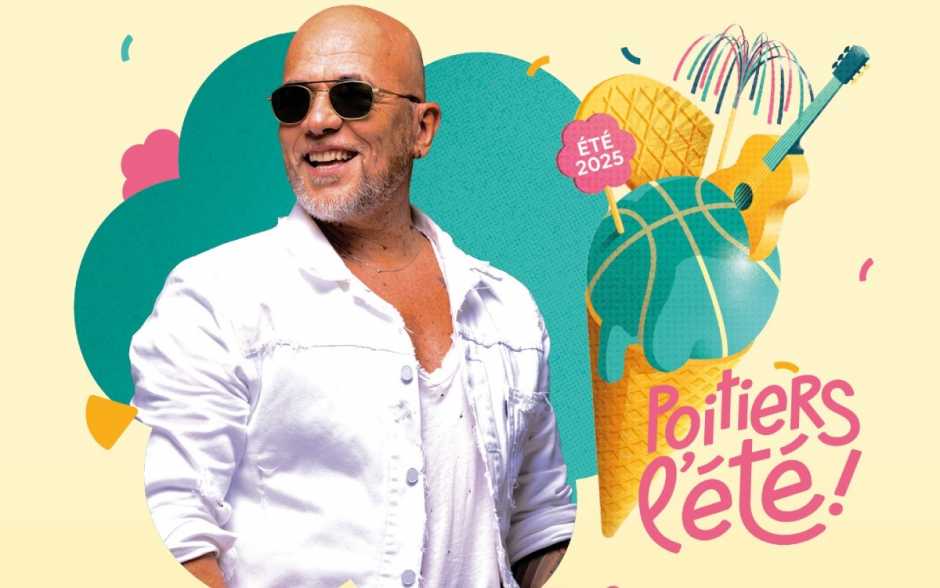
Aujourd'hui

Accusé d’être nocif, le glyphosate est toujours utilisé dans les activités agricoles. Idem pour les néonicotinoïdes dits « tueurs d’abeilles »… Et la liste ne s’arrête pas là ! Comment est-ce possible alors que des scientifiques ont éprouvé la nocivité des pesticides ? Le rapport rendu par l’Inrae, l’Ifremer et l’Inrae jeudi en atteste. Inès Bouchema se propose d’interroger cette apparente contradiction. « Au-delà d’une théorie du complot, en droit, on sait dire pourquoi », assène la jeune doctorante en droit rural. Sa thèse, débutée en octobre 2021 sous la direction du Pr Benoît Grimonprez, porte précisément sur « les instruments juridiques de la sortie des pesticides ». Le mercredi 11 mai, dans le cadre de Pint of science, festival de vulgarisation scientifique ayant pour décor des bars de Poitiers, elle va dévoiler une partie de ses recherches.
« Il ne s’agit pas de dire si l’usage des pesticides est bien ou mal », précise d’emblée la chercheuse dont la thèse s’inscrit dans le projet Fast, lui-même intégré au Programme prioritaire de recherche « Cultiver et Protéger Autrement », lancé en 2019 à l’échelle nationale. « Les pesticides sont en quelque sorte un prétexte pour analyser le droit et s’interroger sur la manière dont il peut contribuer à penser la transition », note Inès Bouchema. Et ce même si « le droit n’a pas vocation à être transitoire. Il dit ce qui doit être ». Et, surtout, il dit comment cela doit être dit.
« Le droit établit un protocole pour fixer la norme », rappelle la doctorante. Si la recherche scientifique ne s’y conforme pas, ses conclusions ne sont pas prises en compte… Et les pesticides restent autorisés ! C’est -presque- aussi simple que cela. De même, les effets nocifs sont listés, au risque que certains passent en-dessous des radars juridiques. « Par exemple, pendant longtemps, les perturbateurs endocriniens n’ont pas été définis en droit. Or ce qui n’est pas défini n’existe pas. » Parfois aussi la définition peut en elle-même constituer un obstacle. « Aujourd’hui, il existe une seule définition juridique de pesticide et elle désigne tout produit qui garantit la santé des plantes. » Littéralement, le glyphosate, le purin d’ortie, la bouillie bordelaise (mélange de souffre et de cuivre) et la levure de bière sont des pesticides égaux aux yeux du droit.
Pour tenter de définir comment le droit peut accompagner la transition écologique, Inès Bouchema s’appuie sur un vaste corpus de textes incluant des articles des code rural et de l’environnement (parfois discordants), des textes européens, des décisions ministérielles, des contrats de filières mais aussi les critiques de juristes, ONG, industriels… « C’est une matière mouvante, convient la doctorante. Il y a un vrai besoin de connaissances scientifiques juridiques sur le sujet. »
« Ecologie et juridiction des pesticides », mercredi 11 mai, à 19h, au Palais de la bière, à Poitiers. Tout le programme de Pint of science, jusqu’à samedi, sur pintofscience.fr.
À lire aussi ...
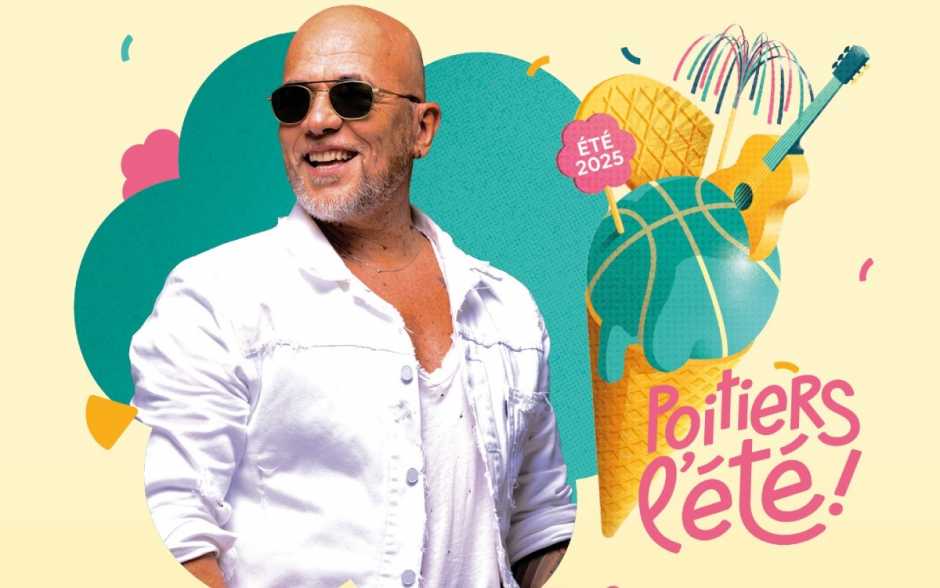
Aujourd'hui