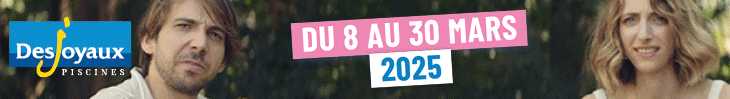Face à la montée des violences sexuelles en lignes, l’association Stop Fisha, créée en 2020, a élaboré un véritable plan de lutte.
« Je faisais des FaceTime avec un ami. Petit à petit, on a commencé à se chauffer, se dénuder… Un jour, il m’a enregistrée à mon insu et a posté la vidéo sur Snapchat. Je l’ai supplié de la supprimer, mais c’était trop tard, tout le monde avait vu. Ça se diffusait, j’étais insultée, dévisagée… »
L’histoire de Laura, co-fondatrice et vice-présidente de l’association Stop Fisha, est loin d’être un cas isolé. L’étudiante poitevine a subi ce qu’on appelle du cyberharcèlement sexuel. Le phénomène regroupe toutes les formes d’agressions en ligne :
diffusion d’images intimes sans consentement, slut-shaming, chantage et demandes de rançon, dick pick, deepfake (voir glossaire ci-contre)… Ces agressions numériques peuvent toucher tout le monde. En 2020, 40% des moins de 50 ans, majoritairement des femmes, étaient concernés, dont 22% des 18-24, ainsi que des mineurs. C’est là que Stop Fisha intervient.
Le rôle de Stop Fisha
« On a créé Stop Fisha en mars 2020, suite à une montée d’appels à l’aide après le confinement », explique Juliette Boris, membre du conseil d’administration. Forte de soixante-quinze bénévoles, l’association opère sur Internet dans l’ensemble du territoire français et en Outre-Mer. Elle est le premier centre d’aide aux victimes de cyberharcèlement sexuel, avec déjà plus d’un millier de sollicitations en 2022.
Stop Fisha s’articule en trois pôles. D’abord l’accueil des victimes : « On leur explique les premiers réflexes, comme capturer les preuves. Ensuite, on les dirige vers une sexologue, des psychologues des services de santé universitaires, et vers l’avocate Rachel-Flore Pardo (co-fondatrice de Stop Fisha, ndlr) qui nous aide depuis le début ». Le pôle enquête s’incruste, lui, dans les comptes fisha afin de dénoncer et signaler les agresseurs. Enfin, le pôle sensibilisation s’efforce
d’« éduquer aux dégâts mentaux et physiques (phobie scolaire, trouble alimentaire, dépression voire suicide, ndlr) supportés par les victimes et d’alerter sur les peines encourues ».
Une réponse judiciaire insuffisante
Si le cyberharcèlement est un délit (de 45 000€ à 75 000€ d’amende et des peines de prison de 2 à 3 ans), les sanctions sont presque inexistantes. Ainsi, de nombreuses plaintes ne font pas l’objet de poursuites ou sont refusées, ce qui est en théorie interdit : « L’une des victimes que nous suivons est en procédure depuis 2011, sans résultats. » Le parquet de Poitiers indique qu’aucune plainte n’est en cours d’instruction à ce jour.
Autre problème, la « méconnaissance » d’Internet et des réseaux (principalement Instagram, Snapchat et Telegram) par les mondes politique et judiciaire. Le législateur et la justice peinent à assurer une véritable modération, notamment sur Telegram, réseau russe intouchable qui accueille des comptes fisha suivis par plus de 200 000 personnes. Pour élargir sa lutte, Stop Fisha compte monter un observatoire chiffré de toutes les cyberviolences sexuelles. Une décision dans la droite ligne du travail de sensibilisation déjà amorcé par l’association, à savoir son dictionnaire de cyberviolence, Combattre le cybersexisme, et son aide pour la mise en place de l’European Digital Service Act, autrement dit la modération des violences en ligne.
Théophanie Le Dez
DR Editions LeDuc